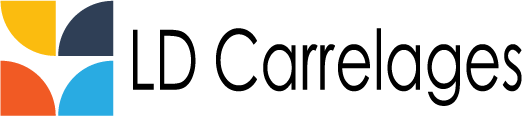Comprendre les joints de carrelage est indispensable pour garantir la durabilité, l’esthétique et l’étanchéité d’un revêtement. Que ce soit pour une salle de bains, une terrasse ou une cuisine, le choix du joint, sa mise en œuvre et son entretien jouent un rôle majeur dans le rendu final du carrelage. Ce guide répond aux interrogations les plus courantes : quels types de matériaux utiliser, comment poser les joints correctement et comment les entretenir pour éviter les moisissures ou fissures.
Les différents types de joints de carrelage : matériaux, usages et esthétiques
Tableau des principaux types de joints : ciment, epoxy, résine, souple…
Chaque type de joint de carrelage possède ses spécificités techniques et esthétiques. Selon l’usage, l’exposition à l’humidité, les contraintes mécaniques ou le rendu recherché, le choix du matériau de jointoiement doit être réfléchi. Le tableau ci-dessous présente une synthèse des principaux types de joints utilisés dans la pose de carrelage, avec leurs caractéristiques, avantages et domaines d’application privilégiés :
| Type de joint | Caractéristiques | Utilisation recommandée | Avantages | Inconvénients |
|---|---|---|---|---|
| Joint en ciment | À base de ciment, souvent proposé en poudre à mélanger à l’eau | Intérieur (sols, murs), pièces sèches à faiblement humides | Facile à appliquer, économique, disponible en plusieurs teintes | Sensible aux taches et à l’humidité, entretien régulier nécessaire |
| Joint époxy | Résine bicomposante très résistante aux produits chimiques et à l’eau | Douches, hammams, piscines, cuisines professionnelles | Étanche, antibactérien, haute durabilité | Pose technique, temps de travail court, coût élevé |
| Joint en résine (urée-alcool, polyuréthane) | Mélange de résines synthétiques offrant une bonne élasticité | Supports sensibles aux mouvements, sols chauffants | Souple, résistant aux fissures, bonne adhérence | Moins courant, prix plus élevé, choix limité de couleurs |
| Joint souple (mastic acrylique ou silicone) | À base de polymères, appliqué en cartouche avec pistolet | Angles, jonctions carrelage/mur ou carrelage/sanitaire | Élastique, absorbe les mouvements, étanche | Ne convient pas aux grands surfaces, exposition aux UV à contrôler |
Ce tableau offre une vue d’ensemble utile pour choisir le joint de carrelage adapté à son projet, tout en prenant en compte les contraintes techniques et l’aspect esthétique recherché. Un bon choix de joint participe directement à la longévité et à la facilité d’entretien du revêtement.

Comment choisir un joint de carrelage en fonction de la pièce et de l’usage
Le choix du joint de carrelage ne repose pas uniquement sur des critères esthétiques. Il doit avant tout s’adapter à l’environnement dans lequel il sera posé. En intérieur comme en extérieur, chaque pièce impose des contraintes spécifiques – humidité, variations thermiques, passages fréquents – qu’il convient d’anticiper pour garantir la durabilité du revêtement.
Dans une salle de bains ou une cuisine, zones à forte humidité, il est recommandé d’opter pour un joint époxy, parfaitement étanche et résistant aux moisissures. Il protège efficacement contre les infiltrations d’eau et reste stable dans le temps, même en présence fréquente de produits ménagers agressifs. Pour les douches à l’italienne ou les hammams, c’est même un choix incontournable.
À l’inverse, dans des espaces comme un salon, un hall d’entrée ou un couloir, soumis à un trafic modéré, un joint ciment classique suffit généralement. Facile à appliquer et économique, il se décline également dans un large éventail de teintes permettant de jouer sur les contrastes ou l’uniformité du rendu visuel.
Pour l’extérieur ou les zones soumises à des contraintes mécaniques (comme une terrasse ou un sol soumis à de fortes amplitudes thermiques), mieux vaut privilégier un joint souple ou un joint à base de résine. Ces matériaux absorbent plus aisément les mouvements de dilatation et évitent les fissures. Ils sont aussi particulièrement adaptés aux planchers chauffants ou aux supports instables.
Enfin, il est essentiel d’adapter la largeur du joint non seulement au format des carreaux, mais aussi à l’usage. Un joint mince de 2 mm pourra convenir pour des petits formats en intérieur, tandis qu’un joint plus large (4 à 10 mm) est préférable pour des carreaux extérieurs ou de grandes dimensions, afin d’absorber les éventuelles tensions du support.

Couleurs, finitions et largeur de joint : quel impact sur l’esthétique finale
Bien au-delà de leur rôle purement technique, les joints de carrelage influencent directement le rendu visuel d’un revêtement, que ce soit au sol ou au mur. Trois paramètres sont particulièrement déterminants : la couleurfinitionlargeur
La couleur du joint permet de jouer subtilement avec les tonalités du carrelage. Un joint ton sur ton crée un effet de surface continue, idéale pour les intérieurs minimalistes ou les grands formats. À l’inverse, opter pour une teinte contrastée – par exemple un joint anthracite sur un carrelage blanc – met en valeur le dessin des carreaux, accentue le calepinage et dynamise la composition de la pièce. Ce choix est particulièrement prisé dans les univers industriels ou contemporains.
La finition du joint vient également affiner le rendu général. Un joint mat atténue les reflets et s’intègre discrètement dans les surfaces naturelles ou brutes. Une finition légèrement satinée apporte quant à elle une touche contemporaine et facilite l’entretien, notamment dans les cuisines et salles d’eau. Plus rare, le joint brillant reste une option audacieuse, souvent réservée à des projets décoratifs volontaires ou artistiques.
Enfin, la largeur du joint influence la perception des volumes et le rythme visuel. Un joint étroit, de 2 à 3 mm, valorise les carreaux de petite dimension ou les carrelages rectifiés, proches d’un rendu de dalle pleine. En revanche, une largeur plus marquée – de 4 mm à plus de 8 mm – donne du relief, facilite les corrections de niveau et sied mieux aux formats XXL ou en pose opus. Elle crée également un cadre graphique qui peut devenir un élément de style à part entière.
Le mariage entre ces trois éléments doit donc être soigneusement réfléchi pour que le carrelage et ses joints forment un ensemble cohérent, tant sur le plan esthétique que fonctionnel. Adapter couleur, texture et espacement permet de renforcer l’effet recherché, qu’il soit discret, élégant ou affirmé.
Comment poser des joints de carrelage : étapes clés et erreurs à éviter
Préparer les carreaux avant le jointoiement : nettoyage, humidité, outils
Avant d’entamer l’étape du jointoiement, la préparation minutieuse des carreaux est essentielle pour garantir un résultat esthétique et durable. Un support propre, sec et uniforme conditionne l’adhérence et la tenue dans le temps du matériau de joint. La négliger, c’est souvent compromettre le travail réalisé en amont.
La première phase consiste à effectuer un nettoyage approfondi des carreaux et des interstices. À l’aide d’un balai à poils rigides ou d’un aspirateur, on élimine poussière, résidus de colle, grains de sable ou éclats de carrelage. Pour les traces de colle persistantes, une spatule en plastique ou un grattoir spécial peut être utilisé, sans endommager les bords du carreau. Cette étape est cruciale : un joint appliqué sur un support sale adhérera mal et risquera de s’effriter prématurément.
Le contrôle de l’humidité des carreaux vient ensuite. S’ils ont été posés récemment, il faut respecter un temps de séchage de la colle variant entre 24 à 48 heures selon les produits utilisés. En cas de doute, il est conseillé d’attendre un minimum de 48 heures pour éviter que l’humidité ne remonte à travers le mortier de jointoiement, ce qui nuirait à son durcissement homogène.
Il est également recommandé de légèrement humidifier les joints à l’aide d’une éponge propre juste avant l’application du joint, notamment par temps chaud ou pour les joints en ciment. Cela limite l’absorption de l’eau contenue dans le mélange de joint et favorise un séchage progressif, plus résistant face aux fissurations.
Quant à l’outillage, il convient de préparer trois éléments indispensables :
- Une raclette en caoutchouc ou taloche à joint, pour répartir le produit de manière homogène sans l’écraser
- Un seau d’eau propre avec une éponge hydrophile à gros grains, pour nettoyer l’excédent en surface
- Un chiffon sec en coton ou une monobrosse (pour les grandes surfaces) permettant de lustrer le carrelage en fin de travail
La qualité de la préparation avant le jointoiement se reflète directement dans la finition des joints de carrelage. Prendre le temps d’un nettoyage rigoureux, contrôler le taux d’humidité du support et utiliser les bons outils augmente significativement la durabilité de l’ouvrage et réduit les risques de désordre à moyen ou long terme.
Liste des étapes pour réussir ses joints de carrelage comme un pro
La réussite d’un joint de carrelage repose autant sur la technicité du geste que sur le respect rigoureux des différentes étapes de mise en œuvre. Ces étapes doivent être suivies avec méthode pour garantir non seulement un rendu esthétique soigné, mais aussi une tenue durable dans le temps, à l’intérieur comme à l’extérieur.
- Préparer le mélange de joint : Respecter les dosages indiqués par le fabricant est essentiel. Le mélange doit être homogène, ni trop sec ni trop liquide, pour faciliter l’application et garantir un séchage uniforme. Utiliser un malaxeur électrique permet d’obtenir une pâte lisse sans grumeaux.
- Appliquer le joint sur les carreaux : À l’aide d’une taloche en caoutchouc, étaler le produit en diagonale par rapport aux joints, afin de bien les remplir sans déplacer les carreaux ou entraîner un surdosage.
- Retirer l’excédent : Dès que le joint commence à tirer (quelques minutes après l’application selon la température ambiante), utiliser une éponge humide pour enlever l’excédent sur le carreau. L’éponge doit être régulièrement rincée pour éviter de salir à nouveau la surface.
- Lisser les joints : Une fois que le joint commence à durcir, passer un doigt humide ou un outil arrondi le long de chaque joint pour affiner l’aspect et assurer un résultat uniforme. C’est une étape souvent négligée qui améliore beaucoup la finition.
- Laisser sécher : Respecter un temps de séchage complet, généralement compris entre 12 et 24 heures (selon le type de joint) avant toute reprise de circulation ou mise en eau.
- Nettoyer les voiles de ciment ou résidus : Après séchage, un dernier nettoyage avec un chiffon doux ou, dans les cas les plus encrassés, un nettoyant spécifique pour voile de ciment permet de redonner tout son éclat au carrelage.
Cette liste d’étapes constitue un socle de bonnes pratiques pour exécuter des joints de carrelage professionnels. Elle s’applique aussi bien aux projets neufs qu’aux rénovations. Respecter cette chronologie et adapter ses gestes aux spécificités du matériau utilisé (ciment, résine, époxy…) permet de limiter les erreurs fréquentes comme les bulles d’air, les décollements précoces ou les effets de retrait au séchage.
Erreurs courantes à éviter lors de la pose des joints (fissures, mauvaise application…)
Malgré une préparation rigoureuse, certaines erreurs fréquentes lors de la pose des joints de carrelage peuvent compromettre le résultat final, tant sur le plan esthétique que structurel. La fissuration reste l’un des problèmes les plus récurrents, notamment lorsqu’un joint ciment est appliqué sur un support encore humide ou instable. Cette défaillance est souvent due à une absence de temps de séchage suffisant entre la pose des carreaux et le jointoiement, ou à des mouvements du support mal anticipés en l’absence de joints de fractionnement.
Une application trop sèche ou trop liquide du mélange constitue également une source de désordre. Un joint trop sec accroche mal les flancs du carreau et provoque une prise hétérogène du mortier, tandis qu’un mélange trop liquide entraîne une rétractation excessive en séchant. Cela se traduit par des joints creusés, friables, voire désolidarisés du carrelage quelques semaines après la pose.
Parmi les maladresses techniques souvent observées, on note aussi le remplissage incomplet des interstices, lié à un passage de raclette trop rapide ou désordonné. Ces vides invisibles à l’œil nu, mais bien réels, créent des zones de faiblesse où l’eau peut s’infiltrer, surtout dans les zones humides (douche, cuisine). De même, un nettoyage trop précoce de la surface des carreaux peut retirer trop de matière dans le joint encore frais, ce qui aboutit à des formes irrégulières et nuisent à l’étanchéité.
Il faut également éviter l’erreur de compatibilité entre le matériau du joint et le support. Utiliser un joint ciment classique sur un sol chauffant ou flexible, sans produit adapté ou joint souple, expose rapidement à l’apparition de microfissures. Dans les cas extrêmes, cela peut mener malheureusement au décollement partiel du carrelage ou à des infiltrations sous le revêtement.
Enfin, négliger le respect du temps de séchage complet avant la rénovation ou la circulation est une erreur finale mais critique. Circuler trop tôt sur un sol fraîchement jointoyé comprime ou abîme les rainures encore molles et laisse souvent des traces définitives sur la surface des carreaux.
Une pose de joints réussie demande donc autant de patience que de minutie. Respecter les bons dosages, bien choisir son produit, adapter sa technique à la pièce concernée et surveiller l’évolution du séchage permettent d’éviter les erreurs courantes et d’accroître significativement la durabilité des joints.
Entretenir et rénover ses joints de carrelage : conseils pour un aspect toujours propre
Nettoyer les joints au quotidien : produits efficaces et gestes simples
Entretenir les joints de carrelage régulièrement est la clé pour conserver un aspect propre et prévenir les moisissures, en particulier dans les zones sujettes à l’humidité comme la salle de bains ou la cuisine. Sans attendre que les salissures s’accumulent, quelques gestes simples intégrés à l’entretien hebdomadaire suffisent à préserver leur éclat d’origine.
Le nettoyage peut s’effectuer avec des produits du quotidien à portée de main. Une solution composée de vinaigre blanc dilué (moitié eau, moitié vinaigre) appliquée à l’aide d’une brosse à dents ou d’un pinceau dur permet d’éliminer les traces de savon, de calcaire et les dépôts graisseux. Pour renforcer l’effet désincrustant, il est possible d’ajouter une cuillère de bicarbonate de soude, formant une action légèrement moussante, idéale pour détacher sans agresser les matériaux. Ce mélange naturel est particulièrement recommandé pour les joints en ciment, souvent plus poreux et donc plus sensibles aux encrassements.
En cas de salissures récalcitrantes ou de taches noires dans les joints de douche, l’usage ponctuel d’un nettoyant spécifique pour joints, à base d’agents antifongiques, peut s’avérer utile. Ces produits sont disponibles sous forme de spray ou de gel à laisser agir quelques minutes avant brossage. Pour un résultat optimal, il est conseillé de rincer abondamment à l’eau tiède puis de sécher la surface avec un chiffon microfibre, afin d’éviter la réapparition des traces d’humidité.
Quelques gestes quotidiens permettent également de prolonger la propreté des joints :
- Ventiler les pièces humides après chaque usage (ouverture de fenêtre ou activation de la VMC)
- Sécher rapidement les parois carrelées dans les douches ou autour de l’évier
- Passer un chiffon humide sur les carreaux au moins une fois par semaine
Enfin, pour limiter l’adhérence des taches, il est possible d’appliquer de façon préventive un hydrofuge spécial pour joints. Ce type de produit forme une barrière invisible qui protège les lignes de joint tout en laissant respirer le support, améliorant ainsi leur résistance à l’eau et aux salissures. Une application tous les 6 à 12 mois suffit généralement pour maintenir une excellente protection sur le long terme.
Que faire face à des joints noircis, fissurés ou moisis : rénovation partielle ou totale
Face à des joints de carrelage abîmés – qu’ils soient noircis par l’humidité, fissurés par les mouvements du support ou encore moisis dans les zones humides –, il est essentiel de déterminer s’il convient d’opter pour une rénovation partielle ou totale. Le choix dépend de plusieurs facteurs : l’état général des joints, la nature du dommage, la pièce concernée et le type de joint initialement utilisé.
Dans le cas de salissures localisées ou de moisissures superficielles, un nettoyage en profondeur combiné à une réhydrofugation peut suffire. Si cependant des zones entières sont atteintes, notamment dans les salles de bains ou douches à l’italienne, ou si les joints présentent des fissures continues ou un décollement visible, il devient pertinent d’envisager une reprise partielle ou complète.
Une rénovation partielle consiste à gratter puis remplacer uniquement les sections endommagées. Cela peut convenir lorsque les dégâts sont concentrés dans certaines zones : par exemple au niveau d’un angle de mur ou autour d’un siphon de douche. Cette solution est moins coûteuse, mais demande de trouver une teinte de joint identique, ce qui n’est pas toujours aisé si le produit d’origine est ancien ou a jauni avec le temps.
En revanche, lorsque l’ensemble des joints montre des signes d’usure avancée, que le fond du joint devient friable, ou que l’adhérence a disparu, il est préférable de procéder à une rénovation totale. Cette opération implique le retrait complet de tous les anciens joints à l’aide d’un outil multifonction ou grattoir spécial, suivi de l’application d’un nouveau produit de jointoiement adapté à l’environnement : seringue de mastic silicone pour les zones sanitaires, joint époxy haute performance pour les douches ou zones carrelées très exposées.
Il est important de noter que changer les joints peut transformer l’esthétique d’une pièce tout autant qu’un nouveau carrelage. C’est aussi une occasion de corriger de futurs défauts : infiltration d’eau, migrations bactériennes ou mauvaise évacuation. Pour ceux souhaitant améliorer la performance globale, c’est un excellent moment pour basculer vers un joint nouvelle génération, comme les formulations époxy à entretien simplifié, ou les gammes anti-moisissures renforcées.
Produits et traitements pour prolonger la durée de vie et l’étanchéité des joints
Prolonger la durabilité et l’étanchéité des joints de carrelage ne repose pas uniquement sur un bon choix de matériau ou une pose soignée. Il existe aujourd’hui une large gamme de produits complémentaires conçus pour renforcer la protection des joints contre les agressions extérieures : humidité, moisissures, taches grasses ou encore rayons UV. Ces traitements permettent non seulement d’optimiser les performances techniques à long terme, mais aussi de maintenir l’aspect esthétique d’origine, sans besoin de rénovation prématurée.
Le premier outil essentiel est le traitement hydrofuge pour joints, applicable sur des joints neufs comme en entretien régulier. Ces solutions, généralement à base de silanes ou siloxanes, pénètrent dans la surface du joint et forment une barrière imperméable à l’eau tout en laissant respirer le matériau. Elles empêchent l’humidité de s’infiltrer, limitent le développement de moisissures et réduisent l’encrassement. Transparentes et invisibles après séchage, elles n’altèrent ni la couleur ni la texture des joints. L’application tous les 6 à 12 mois est recommandée dans les zones d’eau (salle de bain, cuisine, extérieur).
Pour les environnements très exposés ou les pièces techniques, les revêtements de finition haute protection offrent une solution plus performante encore. Ce sont des films de surface (souvent bicomposants dans le cas de finitions pro) qui créent une couche protectrice dure et brillante sur les joints à base de ciment. Très utilisés dans les lieux publics ou cuisines commerciales, ils protègent efficacement contre les graisses, produits détergents concentrés et intensité du trafic. Certains produits possèdent également des propriétés antibactériennes, utiles en milieu humide constant.
En complément, plusieurs fabricants proposent aujourd’hui des additifs à mélanger directement au mortier de joint. Ces composants, généralement à base de latex ou de polymères spécifiques, améliorent considérablement l’élasticité, l’imperméabilité et la résistance mécanique du joint. Leur usage est particulièrement pertinent lorsqu’on prévoit d’appliquer le mortier sur des surfaces sujettes aux tensions structurales ou à la chaleur (planchers chauffants, terrasses extérieures). Attention toutefois : ces additifs ne sont pas compatibles avec tous les types de joints, notamment les joints époxy, qui sont déjà performants par nature.
Enfin, pour les projets haut de gamme ou les rénovations durables, on peut envisager de compléter le jointoiement classique avec un traitement anti-UV, souvent négligé lors des poses en extérieur. Très utile sur les joints de terrasse ou autour d’une piscine, ce traitement évite aux pigments clairs de jaunir sous l’effet prolongé du soleil et maintient la justesse des teintes.
Ces différents produits et traitements constituent des outils précieux pour prolonger la protection des joints de carrelage. Bien choisis et appliqués régulièrement, ils réduisent le risque d’entretien lourd, repoussent l’apparition de décollements ou fissures, et participent à conserver un aspect net et professionnel sur l’ensemble du revêtement.